Château d’Avully
Exposition
1000 ans d’histoire en Savoie
Audioguide proposé et réalisé par l’association Savoie.live
Bienvenue au Château
Pour commencer la visite, découvrez l’histoire du Château d’Avully à travers les siècles…
Ecouter l’audio
En savoir
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Château d’Avully !
Je suis ravi de vous accueillir aujourd’hui dans ce lieu vraiment unique, niché ici à Brenthonne, au cœur du Bas-Chablais. Ce que vous allez découvrir, ce n’est pas seulement un château avec de vieilles pierres, c’est huit siècles d’histoire de la Savoie concentrés dans un même lieu.
Alors, imaginez… il y a environ deux mille ans, à l’époque romaine, il y avait déjà ici une villa, c’est-à-dire une grande maison agricole. Et puis, petit à petit, ce site s’est transformé.
Au Moyen Âge, une famille noble, les Avully, y construit une maison forte – une sorte de petit château défensif. On est alors au XIIe siècle. La région est alors un vrai patchwork politique, entre la Savoie, le Dauphiné, Genève… et notre château joue un rôle stratégique très important, un peu comme un poste frontière.
En 1335, en plein conflit entre la Savoie et le Dauphiné, les comtes de Savoie ordonnent de renforcer cette maison forte. On creuse des douves, on ajoute un donjon… bref, le château devient une vraie petite forteresse. Et quand je dis “forteresse”, ce n’est pas seulement une image : à l’époque, les seigneurs d’Avully sont impliqués dans une expédition prestigieuse menée en Orient qui vise à secourir l’Empire byzantin menacé par les Ottomans.
Puis, au XVIe siècle, une nouvelle famille s’installe : les Saint-Michel, des bourgeois de Genève devenus riches et influents. Ils transforment Avully en une belle demeure Renaissance. Mais l’histoire s’emballe : on est en pleine Réforme protestante. Le château devient un bastion protestant, avant de basculer à nouveau du côté catholique grâce à Antoine de Saint-Michel, un personnage haut en couleur, converti par nul autre que François de Sales. Autant vous dire que le château devient un vrai symbole religieux à cette époque.
Ensuite, on entre dans une phase plus paisible sous l’Ancien Régime. Les propriétaires vivent entre le château l’été et la cour à Turin l’hiver. Mais en 1793, pendant l’occupation de la Savoie par les révolutionnaires français, le château est pillé, ruiné et abandonné. Pire : en 1860, toutes les archives du château sont brûlées. Une véritable tragédie pour les historiens !
Et puis, miracle. En 1970, Jean Guyon, passionné de patrimoine, rachète les ruines et se lance dans une restauration titanesque. Pendant trente ans, pierre après pierre, il redonne vie à Avully. Et grâce à sa famille, qui continue aujourd’hui encore à entretenir et animer le château, ce lieu est redevenu vivant.
Aujourd’hui, Avully, c’est un musée, un lieu d’événements, un site ouvert à tous… et surtout, un témoignage magnifique de ce que peut devenir un monument historique quand il est aimé et préservé.
Alors ouvrez grand les yeux, car chaque mur ici vous raconte une histoire !
Je vous souhaite une bonne visite, et vous donne rendez-vous dans la partie du musée, pour découvrir ensemble, l’exposition proposée par l’association Savoie.live : 1000 ans d’Histoire en Savoie !
Visite de l’exposition
1000 ans d’Histoire en Savoie
L’exposition se situe dans la partie Musée du château au 1er étage, mais chaque pièce du château recèle ses propres trésors à découvrir, sans oublier le magnifique jardin qui prolonge la visite en plein air
1
Statuta Sabaudiae
Statuta Sabaudiae : édité par Amédée VIII en 1420. Edition originale imprimée en 1530 à Turin.
Ecouter l’audio
En savoir
Nous avons ici l’un des textes les plus importants de l’histoire de la Savoie : les Statuta Sabaudiae, rédigés en 1430 par le duc Amédée VIII de Savoie. Ce document marque un tournant majeur dans l’organisation juridique et administrative des États de Savoie. Ce texte fondateur accompagne la transformation en 1416, du comté de Savoie en Duché.
Mais ce travail n’est pas sorti de nulle part. Il s’inscrit dans une tradition plus ancienne, qui commence dès le XIIIe siècle. À cette époque, Pierre II de Savoie, inspiré par la Grande Charte d’Angleterre et la loi Gombette, amorce un processus de mise par écrit des lois. Ses successeurs continuent cet effort. Amédée VI, en 1379, puis Amédée VIII lui-même en 1403 avec un premier texte appelé Antiqua Sabaudiae, participent à ce mouvement. En 1416, Amédée VIII est élevé au rang de duc par l’empereur Sigismond, conférant ainsi une souveraineté totale à la Savoie. Et en 1430, il finalise et publie les Statuta Sabaudiae, un texte bien plus abouti que tout ce qui avait été fait auparavant.
Les Statuta Sabaudiae sont souvent qualifiés de “constitution” de la Savoie. Ce recueil servait de référence pour la justice dans tout le duché, et même au-delà. Il commence par une profession de foi chrétienne, montrant l’importance de la religion comme fondement moral et social.
Ce texte avait plusieurs objectifs. Le principal était d’assurer une justice équitable, rapide et accessible à toute la population, y compris aux plus pauvres. Une mesure emblématique fut l’institution d’un avocat gratuit pour les personnes démunies, ce qui montre une volonté de justice sociale avant l’heure. Les statuts abordaient aussi l’administration des terres, le rôle des princes, des grands officiers, des magistrats, des baillis et des châtelains, mais aussi l’honnêteté exigée des notaires et des marchands. Ils réglaient même les salaires des travailleurs et les vêtements autorisés selon les classes sociales, pour éviter que l’affichage excessif de richesses ne crée des tensions.
Le texte décrivait aussi l’organisation politique du duché. Le duc n’exerçait pas un pouvoir isolé : il s’appuyait sur plusieurs conseils. Le Conseil ducal, présidé par le chancelier, se réunissait tous les jours pour traiter les affaires diplomatiques et judiciaires. Le Conseil résident de Chambéry, ancêtre de notre Cour d’appel, était convoqué pour juger les affaires les plus importantes, civiles et criminelles. L’Assemblée des trois états, qui regroupait les représentants du peuple, du clergé et de la noblesse, était également prévue pour les grandes décisions. Enfin, la Chambre des comptes, perfectionnée par Amédée VIII, gérait la comptabilité de tout le duché et contrôlait les finances publiques.
Les Statuta Sabaudiae ont eu un impact durable. Ils ont permis de centraliser l’administration et de renforcer l’efficacité de l’État. Certaines de leurs dispositions sont restées en vigueur jusqu’au XVIIIe siècle. Ce texte a aussi servi de base pour d’autres codifications, comme le Code Victorin en 1723 ou le Statut fondamental de 1848.
Au final, les Statuta Sabaudiae ne sont pas qu’une simple compilation de lois : ils ont permis d’unifier la Savoie, de poser les bases d’un État organisé, juste et centralisé. Ils témoignent de l’ambition d’Amédée VIII de construire un duché fort, stable et prospère, et leur influence a traversé les siècles.
2
Codex Fabrianus
Code des lois : rédigé par Antoine Favre en 1598. Edition originale imprimée en 1620.
Ecouter l’audio
En savoir
Nous allons parler ici d’un ouvrage très important, mais pas forcément connu du grand public : le Codex Fabrianus. Ce texte, rédigé en 1598, est en quelque sorte le grand livre de loi de la Savoie. Il a été écrit par un homme remarquable, Antoine Favre, dont je vais vous raconter l’histoire.
Antoine Favre est né en 1557 à Bourg-en-Bresse, une région qui faisait alors partie des États de Savoie. Son père était déjà un haut magistrat, donc on peut dire qu’Antoine a baigné très jeune dans le monde du droit. Après des études de droit et de jurisprudence à Turin, il devient avocat à seulement 22 ans, ce qui montre déjà son talent. Rapidement, il gravit les échelons : d’abord juge-mage en Bresse, il est ensuite nommé sénateur à Chambéry en 1587.
Mais Antoine Favre n’était pas seulement un juriste. C’était aussi un homme cultivé, proche de figures importantes comme Honoré d’Urfé, le célèbre écrivain, et François de Sales, futur saint. Avec François de Sales, il fonde en 1594 la Confrérie des pénitents de la Sainte-Croix, un groupe de laïcs qui se consacraient à des œuvres de charité. Puis, en 1606, ils créent ensemble l’Académie florimontane, un cercle savant pour échanger sur la théologie, les lettres, les sciences… Cette académie inspirera d’ailleurs plus tard la fondation de l’Académie française par le fils d’Antoine, Claude Favre de Vaugelas. Antoine Favre a eu dix enfants, dont plusieurs sont devenus eux-mêmes sénateurs !
En 1610, grâce à ses compétences reconnues, il est nommé Premier Président du Sénat de Savoie par le duc Charles-Emmanuel Ier. Il mènera aussi des missions diplomatiques importantes à Rome et Paris. Il décède en 1624 à Chambéry, et son tombeau de marbre noir se trouve dans la cathédrale Saint-François.
Maintenant, parlons du contexte. Le Codex Fabrianus est lié au Sénat de Savoie, qui était la plus haute cour de justice du duché. Ce Sénat est l’héritier du Conseil résident de Chambéry, qui tranchait les affaires civiles et criminelles les plus importantes. Après une période d’occupation française de 23 ans, le Sénat souverain est rétabli à Chambéry en 1559 par Emmanuel-Philibert qui recouvre son Duché. Antoine Favre y siège d’abord comme sénateur, puis comme Premier Président. Sous sa présidence, le Sénat devient l’interprète souverain de la loi, c’est-à-dire que c’est lui qui dit officiellement ce que la loi veut dire.
C’est dans ce cadre qu’Antoine Favre rédige le Codex Fabrianus. Ce texte, regroupant neuf livres, est basé sur l’analyse des arrêts, c’est-à-dire les décisions prises par le Sénat sur une période de dix ans. Même si ces décisions n’étaient pas obligées d’être expliquées, Favre et ses collègues prenaient soin de rédiger des justifications. Le Codex reprend ces explications, les organise et les commente, pour en faire un véritable manuel du droit en Savoie.
Le but était clair : fixer les grandes lignes du droit et assurer la cohérence des jugements. Le Codex est vite devenu la référence absolue pour tous les juristes de Savoie : avocats, magistrats, notaires… Il est resté utilisé jusqu’au traité de cession de 1860. Mais son influence a dépassé les frontières : il a aussi été consulté en France et ailleurs en Europe. Un avocat général du Parlement de Paris a même qualifié Antoine Favre de “plus grand magistrat du monde”, preuve de l’immense respect qu’il inspirait.
En résumé, le Codex Fabrianus n’est pas seulement un livre de lois. C’est le témoignage de l’excellence du droit savoisien et de l’érudition de ses juristes. Grâce à Antoine Favre, le droit est devenu plus clair, plus accessible, et son travail a marqué l’histoire du droit bien au-delà de la Savoie.
3
Saint-François de Sales
Oeuvres de Saint-François de Sales – Evèque et Prince de Genève : Tome I et II. Edition originale imprimée en 1669 à Paris.
Ecouter l’audio
En savoir
Découvrons ici une figure incontournable de l’histoire religieuse et culturelle de la Savoie : Saint François de Sales, né en 1567 et mort en 1622. Il est considéré comme le saint le plus célèbre de la Savoie, connu bien au-delà de nos frontières. Il est à la fois un homme d’Église, un intellectuel et un grand communicateur.
François de Sales est né à Thorens, après que sa mère, qui craignait de ne pas pouvoir avoir d’enfants, ait fait un vœu à Notre-Dame-de-Liesse d’Annecy. Il disait lui-même : « Je suis Savoisien de naissance et d’obligation ». Dès son plus jeune âge, il suit une formation religieuse et intellectuelle solide. Il étudie à Paris, dans un environnement jésuite, en lien avec Pierre Favre, un autre grand Savoisien cofondateur de l’ordre des jésuites.
Au fil des années, il tisse des liens d’amitié avec des personnalités importantes : Antoine Favre, président du Sénat de Savoie, mais aussi des figures comme Saint Vincent de Paul, Saint Charles Borromée et Sainte Jeanne-Françoise de Chantal.
Mais c’est surtout son action missionnaire en Chablais qui marque les esprits. À l’époque, cette région est passée sous influence protestante après l’invasion bernoise de 1536. François de Sales est envoyé pour ramener la population au catholicisme, mais il choisit de le faire sans violence, par la persuasion et la charité. Une anecdote célèbre raconte qu’il écrivait des sermons qu’il glissait sous les portes, pour toucher les habitants discrètement. Il débat avec des grands noms du protestantisme comme Théodore de Bèze, et multiplie les conférences. Sa capacité à communiquer efficacement l’amènera plus tard, à devenir le saint patron des écrivains et des journalistes.
En 1602, il devient évêque de Genève, mais comme la ville reste protestante, il s’installe à Annecy, qui devient son siège épiscopal. En parallèle, il fonde plusieurs institutions : en 1594, avec Antoine Favre, il crée la Confrérie des pénitents de la Sainte-Croix, des laïcs qui viennent en aide aux pauvres et aux malades. En 1606, toujours avec Favre, il fonde l’Académie florimontane, une sorte de club d’intellectuels inspiré des académies italiennes, pour échanger sur la théologie, les sciences et les lettres. Cette académie inspirera plus tard la création de l’Académie française. Et en 1610, avec Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, il fonde l’Ordre de la Visitation, un ordre religieux féminin.
Malgré son importance, François de Sales refuse les honneurs : les rois de France tentent de le nommer archevêque de Paris, mais il préfère rester fidèle à sa Savoie.
Côté écrits, il laisse de véritables best-sellers spirituels, comme L’Introduction à la vie dévote et Le Traité de l’Amour de Dieu. Ces livres connaissent un succès immédiat, traduits et réédités dans toute l’Europe, et restent encore publiés aujourd’hui.
Après sa mort en 1622, sa béatification commence seulement cinq ans plus tard, preuve de sa popularité. Il est canonisé en 1665, proclamé Docteur de l’Église en 1877, et devient le protecteur des quatre diocèses de Savoie.
Son action a transformé le Chablais, passant d’une majorité protestante à une majorité catholique, marquant durablement l’identité de la région. Il est enterré dans la basilique de la Visitation à Annecy, où de nombreux pèlerins viennent encore. Sa fête est célébrée chaque 24 janvier.
En somme, Saint François de Sales fut un acteur majeur de la Contre-Réforme, un humaniste, un pasteur proche des gens, dont l’héritage religieux, intellectuel et culturel continue de rayonner bien au-delà de la Savoie.
4
Emmanuel-Philibert
Statue d’Emmanuel-Philibert réalisée par Carlo Marochetti en 1838-39 (Bronze).
Ecouter l’audio
En savoir
Découvrons maintenant ce magnifique bronze d’Emmanuel-Philibert de Savoie, représenté triomphant, rentrant à cheval dans Chambéry. Ce n’est pas la grande statue que l’on trouve à Turin, mais une miniature, réalisée par le sculpteur Carlo Marochetti. Il s’agissait d’un modèle réduit, destiné à montrer son art. Même dans ce petit format, on ressent toute la puissance de l’œuvre.
Avant de parler de la statue, un peu d’histoire. Emmanuel-Philibert, qu’on surnommait “Tête de Fer”, est une figure majeure de la Savoie. Après l’invasion française de 1536, son duché est occupé pendant 23 ans. La population souffre : impôts écrasants, réquisitions, ruine du commerce. Emmanuel-Philibert, exilé, sert alors son oncle l’empereur Charles Quint et devient un chef militaire redoutable. Sa victoire de Saint-Quentin en 1557 contre les Français est décisive. En 1559, grâce au traité du Cateau-Cambrésis, il récupère ses terres. La statue célèbre son retour triomphal, un symbole de renaissance après ces années de souffrance.
Mais cette œuvre, c’est aussi le reflet du talent de Carlo Marochetti, l’un des grands sculpteurs du XIXᵉ siècle. Né à Turin en 1805, Marochetti a eu une carrière exceptionnelle entre la Savoie, la France et l’Angleterre. Il commence à Paris, se forme auprès de maîtres comme François-Joseph Bosio, puis se fait connaître avec des commandes prestigieuses. L’un de ses premiers grands succès est justement la statue équestre d’Emmanuel-Philibert à Turin, sur la place San Carlo.
Ensuite, il réalise de nombreuses œuvres majeures : à Paris, il sculpte le relief de la bataille de Jemappes sur l’Arc de Triomphe ; il crée le monument à Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans, et contribue à l’autel de l’église de la Madeleine. Puis il s’installe à Londres, où il devient l’un des artistes favoris de la reine Victoria et du prince Albert. Là, il réalise le célèbre Richard Cœur de Lion devant le Parlement de Westminster, le monument au duc de Wellington à Glasgow, et même des œuvres commandées par la Couronne pour l’Inde et la Turquie, comme le mémorial de la guerre de Crimée à Istanbul ou l’ange du Cawnpore Memorial en Inde.
Ces réalisations montrent bien l’ampleur de sa carrière et de son talent. Partout, Marochetti s’est imposé grâce à sa capacité à créer des images fortes, mêlant puissance et élégance. Dans la statue que nous avons ici, il capte cette force d’Emmanuel-Philibert : le duc est représenté fier, le regard droit, les rênes fermement tenues, incarnant le courage et l’autorité restaurée. Ce n’est pas seulement un héros militaire, mais un homme qui revient reconstruire un duché brisé.
En somme, cette petite statue est un condensé d’histoire, de mémoire et d’art, le témoignage d’un moment clé pour la Savoie et d’un sculpteur dont l’œuvre s’est déployée à travers toute l’Europe.
5
Heures de Savoie
Livre d’Heures de Savoie (1330-1340) appartenant à Blanche de Bourgogne épouse du Comte Edouard de Savoie. Fac-similé MS390 – 500 exemplaires. Réalisé par l’université de Yale
Ecouter l’audio
En savoir
Nous avons ici un véritable trésor de l’histoire médiévale de la Savoie : un fac-similé exceptionnel du Livre d’heures de Blanche de Bourgogne. Ce n’est pas un simple livre : c’est un chef-d’œuvre d’art, de foi et de prestige, créé il y a près de 700 ans.
Blanche de Bourgogne, pour vous situer, était la petite-fille de Saint Louis et l’épouse du comte Édouard de Savoie, qu’on appelait “le Libéral”. Après la mort de son mari en 1329, Blanche reste seule avec leur fille et se retire de la vie publique. Ce Livre d’heures, commandé vers 1330-1340, reflète à la fois sa piété personnelle et son statut princier.
Ce livre est un objet précieux et intime. Il est petit, environ 13 centimètres de haut, facile à tenir dans les mains, car c’était un livre de prière pour un usage quotidien. Il est écrit sur parchemin, avec une écriture gothique très soignée, et surtout, il est décoré de miniatures éblouissantes : de l’or brillant, du bleu profond tiré du lapis-lazuli, et des bordures remplies de petits animaux fantastiques et de feuillages élégants.
Ce qui est fascinant, c’est que Blanche apparaît elle-même dans le livre, représentée 25 fois en prière ou en conversation avec des saints. Cela montre à quel point ce livre était personnalisé et précieux pour elle. Côté style, les spécialistes disent qu’il a été peint dans l’atelier de Jean Le Noir, disciple de Jean Pucelle, un des plus grands enlumineurs de l’époque. Le style est proche des Heures de Jeanne d’Évreux, conservées à New York.
Et quelle aventure a connu ce livre ! Après Blanche, il passe entre les mains du roi Charles V, puis de son frère le duc de Berry, célèbre collectionneur de manuscrits. Il inspire même la création des Très Riches Heures du duc de Berry. Plus tard, il revient à la Maison de Savoie et reste à la bibliothèque de Turin… jusqu’à ce qu’un terrible incendie en 1904 détruise l’original avec 4000 autres manuscrits ! Heureusement, en 1910, 26 feuillets rescapés sont redécouverts par hasard à Portsmouth, en Angleterre. Ces fragments sont aujourd’hui conservés à l’université de Yale. Le fac-similé que nous exposons ici est un des 500 exemplaires reproduit à l’identique à partir de ce fragment de pages précieuses.
Mais la Savoie a produit d’autres merveilles enluminées. Un exemple incroyable est l’Apocalypse figuré des ducs de Savoie, réalisé entre 1428 et 1490. Ce manuscrit géant, illustrant les visions de l’Apocalypse de Saint Jean, a été commandé par le duc Amédée VIII. Il montre des anges, des dragons, la Bête, la chute de Babylone… Des images saisissantes, pleines de couleurs et d’or. Ce travail a été commencé par Péronet Lamy, un artiste actif en Savoie, avec Jean Bapter, puis complété par Jean Colombe, connu pour avoir fini les Très Riches Heures du duc de Berry.
Et n’oublions pas le Livre d’heures du duc Louis de Savoie, commandé vers 1440. Ce manuscrit luxueux reflète l’influence des artistes flamands, avec des miniatures d’un réalisme impressionnant et des détails incroyables : les plis des tissus, les paysages en arrière-plan, les expressions des visages. C’était un livre à la fois de prière et de prestige politique, montrant les alliances et la piété du duc.
Ces livres ne sont pas que des objets religieux : ils sont des témoignages de l’art, du pouvoir et de la culture en Savoie au Moyen Âge. Ils illustrent comment la Savoie, à la croisée des routes entre la France, les pays d’Italie et le Saint Empire, a su s’imprégner des influences européennes tout en développant et affirmant sa propre identité.
6
Augustae Regiaeque Sabaudae
Cette ouvrage original réalisé en 1702 par Francesco Maria Ferrero di Lavriano à Turin contient 35 gravures sur cuivre ce qui en fait une pièce très rare et précieuse.
Ecouter l’audio
En savoir
Nous allons découvrir ensemble un ouvrage exceptionnel, un véritable trésor de l’histoire de la Maison de Savoie : l’Augustae Regiaeque Sabaudae Domus Arbor gentilitia, ou si vous préférez… l’Arbre généalogique de la Maison royale de Savoie. Rien que ça !
Alors, imaginez-vous au début du XVIIIe siècle, en 1702. Nous sommes à Turin, capitale du duché de Savoie, et le duc Victor-Amédée II cherche à affirmer son pouvoir, son prestige… et pourquoi pas son avenir royal. Pour cela, il commande cet ouvrage spectaculaire, que nous avons devant nous. Ce n’est pas juste un livre, c’est un outil de communication politique, une véritable arme de prestige.
Cet ouvrage a été conçu par Francesco Maria Ferrero di Lavriano. Il n’était pas seulement historien : il était aussi abbé, artiste, et proche conseiller du duc. Autant dire qu’il savait manier à la fois les mots, l’art et la politique. Son objectif ? Montrer noir sur blanc – et surtout en images ! – que la dynastie des Savoie n’était pas une petite maison régionale, mais bien l’une des plus anciennes et illustres d’Europe.
Regardez bien la taille du livre : un format gigantesque, ce qu’on appelle un in-folio. C’est un livre qu’on expose, qu’on feuillette dans un cabinet d’érudit ou une bibliothèque princière, pas un ouvrage qu’on emmène sous le bras ! Il contient 34 portraits gravés des comtes et ducs de Savoie, depuis le légendaire Bérold, père de Humbert aux Blanches Mains jusqu’à Victor-Amédée II lui-même. Chaque portrait est soigneusement encadré, gravé avec des détails incroyables. Ces images n’étaient pas là juste pour décorer : elles servaient à affirmer la continuité et l’ancienneté du pouvoir.
Un détail amusant : la dernière planche, prévue pour accueillir le portrait du futur duc Charles-Emmanuel III, était laissée vide, simplement ornée d’un cadre. Comme si l’ouvrage disait : “Regardez, l’histoire continue !” Une manière très élégante de dire que la dynastie ne s’arrêtait pas là.
Mais au-delà de la généalogie, cet ouvrage servait un but bien précis : convaincre les autres cours européennes que la Maison de Savoie méritait le titre royal. À l’époque, Victor-Amédée II n’est encore “que” duc, mais il rêve d’être roi. Et ce livre, c’est un peu sa carte de visite, son “CV” dynastique, qu’il peut montrer pour prouver qu’il en a l’étoffe.
Et si vous vous demandez comment on a réalisé ces gravures, sachez qu’elles ont été confiées à des artistes renommés comme Georges Tasnière ou Pierre Giffart, à partir de dessins préparatoires réalisés par François-Jean Dominique Lange un artiste originaire d’Annecy. Ce sont de véritables chefs-d’œuvre de gravure, pleins de finesse et de détails.
Aujourd’hui, l’Arbor gentilitia est conservé dans plusieurs grandes bibliothèques européennes. Il reste un témoignage fascinant de l’art de la propagande visuelle et politique de l’époque baroque. Alors, la prochaine fois que vous voyez un arbre généalogique… pensez qu’au XVIIe siècle, c’était bien plus qu’un simple tableau de famille : c’était un outil de pouvoir !
7
Ordre de Maurice et Lazare
Croix de commandeur de l’ordre de Saint-Maurice et Lazare. Ordre dynastique de la Maison de Savoie.
Ecouter l’audio
En savoir
Voici une pièce vraiment spéciale que j’ai hâte de vous présenter. Ce que vous voyez là, cette croix élégante, c’est une croix de commandeur de l’ordre des Saints-Maurice-et-Lazare. Mais avant de parler de l’objet lui-même, laissez-moi vous raconter l’histoire fascinante qu’elle porte !
Alors imaginez… Nous sommes au XVIe siècle. Le duc Emmanuel-Philibert de Savoie, surnommé “Tête de Fer” pour sa ténacité, vient de récupérer ses États après plus de 23 ans d’occupation française. Pour reconstruire son duché, il a besoin d’affirmer son autorité, de récompenser ses fidèles, mais aussi de montrer au reste de l’Europe que la Maison de Savoie est toujours puissante. Que fait-il ? Eh bien, il décide en 1572 de fusionner deux ordres anciens, l’ordre de Saint-Maurice, créé par ses ancêtres, et l’ordre de Saint-Lazare, issu des Croisades.
L’ordre de Saint-Lazare, c’était à l’origine un ordre d’hospitaliers : ces chevaliers prenaient soin des lépreux à Jérusalem, d’où le mot “lazaret”. Plus tard, ils prennent aussi les armes pour défendre les pèlerins et les lieux saints. L’ordre de Saint-Maurice, lui, avait été fondé par Amédée VIII, premier duc de Savoie, pour regrouper quelques nobles dans une sorte de confrérie pieuse et savante. Emmanuel-Philibert a l’idée géniale de réunir ces deux traditions : le soin, la foi et le combat !
En fusionnant les deux, il crée un ordre à la fois militaire, religieux et… politique. Car chaque chevalier de cet ordre, en recevant sa croix, devient aussi un soutien du duc, un relais de son pouvoir. Au fil du temps, l’ordre va évoluer. Au départ, il participe même à des batailles navales, notamment contre les pirates ottomans en Méditerranée. Mais plus tard, il se tourne surtout vers la charité : hôpitaux, hospices, soins aux malades… Un peu comme une grande association caritative avant l’heure !
Regardez bien cette croix : elle est composée de deux croix superposées. La blanche, avec ses extrémités en forme de trèfle, symbolise l’ordre de Saint-Maurice. La verte, derrière, en forme de croix de Malte, rappelle l’ordre de Saint-Lazare. Et si vous voyez une petite couronne au-dessus, c’est parce qu’après que la Maison de Savoie est devenue royale, on a ajouté la couronne pour montrer l’autorité du roi.
Le grade de commandeur, comme la croix présentée ici est déjà un rang élevé : au-dessus du chevalier et de l’officier, mais en dessous des grands officiers et grands-croix. C’était réservé à ceux qui avaient rendu des services importants au duc, ou plus tard au roi de Sardaigne ou encore les rois d’Italie à partir de 1861.
Aujourd’hui, même si l’ordre n’est plus reconnu officiellement par l’État italien, il existe toujours comme ordre dynastique, sous l’autorité de la Maison de Savoie. Ses membres mènent encore des actions humanitaires et caritatives dans le monde entier.
Alors cette croix, ce n’est pas juste un bijou. C’est un concentré d’histoire : elle raconte l’héritage des Croisades, la foi des ducs de Savoie, les luttes politiques et les œuvres de charité à travers les siècles. Un bel exemple de la manière dont un simple objet peut incarner toute une dynastie !
8
Sceau d’Amédée V
Reproduction en bronze du grand sceau d’Amédée V de Savoie.
Ecouter l’audio
En savoir
Partons à la découverte d’un petit objet… mais qui raconte beaucoup de choses… Ce que vous avez sous les yeux, c’est le sceau d’Amédée V, comte de Savoie, qu’on surnommait “Amédée le Grand”. Et croyez-moi, il n’avait pas volé son surnom !
Alors d’abord, qu’est-ce qu’un sceau, vous me demanderez ? Eh bien, au Moyen Âge, le sceau, c’est un peu l’équivalent de notre signature officielle… mais en bien plus impressionnant ! Chaque prince, chaque seigneur avait son propre sceau. Quand il scellait un document, ça voulait dire : “C’est moi qui l’ai décidé, ça vient de mon autorité.” Et comme on est au Moyen Âge, l’image, le symbole, comptaient autant que les mots : le sceau, c’était la carte d’identité du pouvoir.
Regardez bien celui-ci. Vous voyez Amédée V, à cheval, l’épée levée, prêt au combat. Son casque et même son cheval portent une plume, ce qu’on appelle des cimiers. Mais surtout… regardez son bouclier et la couverture de son cheval. Vous voyez cette grande croix qui traverse de bord à bord ? Eh bien c’est La grande nouveauté de son règne. Avant lui, les comtes de Savoie avaient pour emblème un aigle noir sur fond doré, un symbole impérial, lié au Saint Empire romain germanique. Mais Amédée V, lui, a choisi de mettre en avant cette croix blanche sur rouge. Et pas juste sur son drapeau… non non ! Il l’a mise sur son écu, son bouclier. Ce n’est plus juste un petit fanion accroché à sa lance, comme le faisait son ancêtre Amédée III. Là, c’est officiel : la croix devient l’emblème principal de la Savoie.
Et c’est grâce à ce sceau qu’on sait qu’à partir de son règne, cette croix blanche sur rouge est devenue le symbole définitif de la maison de Savoie. Un peu comme si un roi décidait un jour de changer le drapeau de tout un pays ! Ce choix, c’est à la fois un geste politique et une affirmation d’identité. En choisissant la croix, Amédée V envoie un message : “Je suis chrétien, je défends la foi, et cette croix, c’est celle de mon territoire.” Certains disent même qu’il voulait rappeler ses liens avec l’abbaye de Saint-Maurice, un lieu religieux très important pour la Savoie.
Et puis, bien sûr, il y a l’image du chevalier. À l’époque, être représenté ainsi, à cheval, en armure, l’épée levée… c’était montrer sa puissance militaire, son autorité sur ses terres, mais aussi son rôle de protecteur. Pas seulement un chef politique, mais un seigneur guerrier, prêt à défendre ses sujets.
Ce sceau, ce n’est donc pas qu’un bout de bronze sculpté. C’est un vrai outil de communication politique. Chaque fois qu’Amédée V scellait une charte, un traité, ce symbole voyageait avec le document. C’était comme s’il disait : “Où que ce papier aille, on saura qu’il vient de moi, Amédée, comte de Savoie, seigneur des Alpes.”
Aujourd’hui, on possède encore quelques originaux cachetés par ces sceaux dans les archives à Annecy, Chambéry, Turin et comme les parchemins présentés ici, mais ils sont fragiles : la cire, ça casse ! Les sceaux servant de matrice, étaient détruits à la mort du souverain pour éviter tout risque de faux. C’est pourquoi nous n’avons que des reproductions, comme le sceau d’Amédée V présenté ici. La représentation gravée dans ce sceau puis déposée dans la cire chaude pour empreinte, raconte en fait une grande histoire : celle d’un Prince qui, au tournant des années 1300, a voulu unifier et affirmer son pouvoir, en donnant à la Savoie un emblème simple, fort, et qui est resté le même… jusqu’à aujourd’hui.
Alors, la prochaine fois que vous verrez flotter un drapeau de Savoie, de gueule à croix d’argent, pensez à Amédée V et à son sceau. Parce que ce drapeau que l’on connaît si bien, c’est comme cela qu’il a vraiment pris vie.
9
Samuel Guichenon
Histoire de la Royale Maison de Savoie une œuvre magistrale de Samuel Guichenon publiée en 1660.
Ecouter l’audio
En savoir
Découvrons maintenant derrière cette œuvre, une figure majeure de l’histoire de la Savoie : Samuel Guichenon- Historiographe de la Maison de Savoie. Rassurez-vous, je vais tout vous raconter sans jargon compliqué : ici, pas besoin d’être expert, juste curieux !
Samuel Guichenon naît en 1607 à Mâcon, en Bourgogne, dans une famille de notables : son père est médecin, sa mère issue d’une lignée de juristes. Très jeune, il développe une passion pour l’histoire et les documents anciens. Il se plonge dans les archives, lit les chroniques, recopie des chartes… bref, c’est un véritable rat de bibliothèque ! Son premier grand succès, c’est l’Histoire de Bresse et de Bugey, qui lui vaut d’être remarqué par Christine de France, fille d’Henri IV, épouse de Victor-Amédée 1er, devenue régente de Savoie en 1638 après la mort du Duc.
Christine cherche quelqu’un capable d’écrire une histoire officielle de la dynastie des Savoie, pour asseoir leur prestige et rappeler à l’Europe entière l’ancienneté et l’importance de cette maison princière. Et qui mieux que Guichenon pour cette mission ? Elle l’appelle donc à Turin et le nomme historiographe officiel en 1651. Guichenon reçoit un accès privilégié aux archives ducales et est même anobli !
Après dix ans de travail acharné, il publie en 1660 son chef-d’œuvre : l’Histoire de la Royale Maison de Savoie. À l’époque, c’est une œuvre monumentale, celle que nous vous présentons ici aujourd’hui est tout aussi impressionnante. Il s’agit d’une seconde édition originale de 1778, imprimée à Turin. Elle se compose de quatre livres répartis en cinq volumes, un véritable trésor pour les passionnés d’histoire et de généalogie.
Alors, de quoi parle exactement cette œuvre ? Guichenon y retrace toute l’histoire de la Maison de Savoie depuis ses origines — qui remontent à Bérold, père de Humbert aux Blanches Mains — jusqu’à son époque contemporaine. Il raconte les alliances, les mariages, les batailles, les conquêtes, mais aussi les enjeux politiques. Et surtout, il accompagne son récit de ce qu’il appelle des « preuves » : des copies intégrales de chartes, de traités, de lettres, bref, tous les documents qu’il a soigneusement réunis pour appuyer ses affirmations.
Pour son temps, c’était révolutionnaire. Imaginez : à une époque où beaucoup d’histoires princières étaient encore pleines de légendes et de récits enjolivés, voire de tradition orale, Guichenon veut démontrer, documenter, prouver. Son récit méthodique glorifie les comtes et ducs de Savoie et sert à légitimer leurs droits, notamment sur des territoires disputés. On peut dire qu’il faisait à la fois œuvre d’historien et de communicant politique.
Cette deuxième édition de 1778 que nous exposons ici est rare et précieuse : elle témoigne de l’importance durable de son travail, plus d’un siècle après sa mort. Elle a été utilisée comme référence officielle pour les affaires diplomatiques, les revendications territoriales et l’administration des États de Savoie.
Alors, en regardant ces magnifiques volumes anciens, rappelez-vous : derrière chaque grande dynastie, il y a des hommes comme Guichenon, des artisans de la mémoire, qui façonnent le récit officiel.
10
Lettre patente signée de Charles Emmanuel III de Savoie
Lettre patente, ornée d’un grand sceau et signée par Charles Emmanuel III de Savoie en date du 23 novembre 1760.
Ecouter l’audio
En savoir
Avec ce parchemin, laissez moï vous emmener en 1760, dans le duché de Savoie, au cœur d’un monde où les mots avaient le poids de l’autorité royale et où un document pouvait changer une vie.
Ce que vous avez sous les yeux ici, c’est bien plus qu’un simple manuscrit. C’est une lettre patente, signée par Charles Emmanuel III de Savoie, et marquée de son majestueux sceau de cire rouge. Rien que ça, c’est impressionnant.
Mais laissez-moi vous expliquer ce que cela veut dire, parce que, franchement, ce n’est pas un courrier ordinaire.
D’abord, Charles Emmanuel III, c’est un personnage clé du XVIIIe siècle. Il est roi de Sardaigne, mais aussi duc de Savoie. Un homme puissant, aux multiples titres, comme vous pouvez le lire au début du document – c’est toute une litanie ! Il est duc de Montferrat, marquis d’Italie, prince de Piémont, seigneur de Pignerol, etc. Vous voyez, à l’époque, plus on avait de titres, plus on imposait le respect.
Alors, cette lettre, que dit-elle ? Elle nomme officiellement un homme, Donat Mansord, à une fonction très particulière : celle d’Avocat des Pauvres au Sénat de Savoie. En gros, c’est une sorte d’avocat commis d’office, mais dans un cadre d’élite, le Sénat, qui est une institution judiciaire très prestigieuse à l’époque.
Et ce n’est pas une simple nomination. Le roi y va avec tous les honneurs. Il reconnaît les qualités de Mansord : sa charité, son zèle, son engagement désintéressé… Bref, un bon avocat, au service des plus démunis. Et en contrepartie, il reçoit un gage annuel — une sorte de salaire — de 500 livres, ce qui, à l’époque, représentait une somme assez conséquente.
Ce qui rend ce document encore plus exceptionnel, c’est le sceau de cire rouge. C’est un peu l’équivalent de la signature électronique aujourd’hui… mais en beaucoup plus solennel. Le sceau servait à authentifier le document, et prouvait qu’il venait bien du roi lui-même. Il est apposé avec un cachet, orné des armoiries royales, et ici, vous voyez la boite qui contient le sceau, elle a permi de le conserver des épreuves du temps. On voit bien sa couleur rouge profonde, et le graphisme bien conservé. Un véritable bijou historique !
Alors, imaginez la scène : Mansord reçoit ce document, sans doute avec émotion, et il est désormais l’avocat des plus pauvres dans une des plus hautes institutions du duché. Il devra prêter serment, défendre les plus vulnérables devant les plus puissants… et ce, au nom du roi !
Et ce n’est pas tout : sur les pages suivantes, on trouve les signatures des autorités judiciaires, celles qui l’ont vu prêter serment, et qui officialisent son entrée en fonction. Chaque ligne, chaque mot, chaque signature a ici une valeur légale et symbolique.
En regardant ce document, vous touchez à la fois à la justice d’Ancien Régime, à la vie d’un homme qui a sans doute dédié sa carrière aux autres, et au pouvoir royal, qui s’exerce jusque dans les moindres détails de la vie administrative.
Et c’est ça, la beauté de l’histoire. À travers ce parchemin jauni, c’est tout un monde qui reprend vie sous vos yeux : les institutions, la hiérarchie sociale, l’idée de justice… mais aussi l’humanité, dans ce qu’elle a de plus noble : la défense des plus faibles.
Alors, la prochaine fois que vous verrez un cachet de cire ou une vieille signature, rappelez-vous : derrière l’apparence formelle, il y a toujours une histoire humaine.
Et ici, celle de Dona Mansord, devenu avocat des pauvres, méritait bien d’être racontée.
11
Parchemin enluminée
Authentique vélin ornementé et doré à l’or fin datant du XVème siècle.
Ecouter l’audio
En savoir
Voilà devant vous un véritable trésor du XVe siècle : un parchemin enluminé, autrement dit un extrait manuscrit orné, qui nous vient tout droit de la fin du Moyen Âge. Il ne s’agit pas simplement d’un vieux bout de papier ! Ce que vous avez sous les yeux, c’est à la fois une œuvre d’art et un objet de dévotion.
Ce support, c’est du vélin. Le vélin, c’est une peau d’animal, généralement de veau ou d’agneau, qui a été préparée avec énormément de soin pour devenir un parchemin très fin, très résistant et d’une qualité exceptionnelle. À l’époque, c’était réservé aux documents importants. C’est un peu l’équivalent du papier de luxe aujourd’hui… mais en version médiévale.
Regardez la richesse des couleurs et surtout… les reflets dorés. Ce n’est pas de la peinture dorée : c’est de la véritable feuille d’or ! Appliquée à la main, puis polie pour briller à la lumière. On appelle ça la dorure à l’or fin, et c’était un signe de prestige. On réservait cette technique aux textes religieux ou très nobles.
Ce parchemin faisait très probablement partie d’un livre d’heures ou d’un missel, donc un recueil de prières utilisé lors des cérémonies religieuses ou dans la prière privée.
Sur le côté gauche, vous pouvez admirer cette magnifique décoration florale. On appelle ce style des rinceaux : ce sont des motifs végétaux très fins, très détaillés, typiques du style gothique tardif. Ils symbolisent l’abondance, la vie éternelle… et ils sont là pour magnifier la parole divine.
Si vous observez bien l’écriture, vous verrez qu’elle est très compacte, très rigide, mais régulière. C’est de la gothique textura, une écriture qu’on utilisait beaucoup pour les textes religieux au Moyen Âge. À l’époque, chaque lettre était tracée à la main, à la plume, avec de l’encre noire, souvent mélangée à du charbon ou des pigments naturels.
Quant au texte lui-même, il est écrit en latin, la langue liturgique par excellence. Il s’agit d’un psaume, plus précisément le psaume 128 selon la Vulgate. C’est un texte biblique qui parle de justice divine : il demande à Dieu de punir les ennemis, mais aussi de protéger ceux qui restent fidèles. Une prière très forte, chargée d’émotion et de symbolisme.
Ce type de manuscrit était souvent commandé par des aristocrates ou des membres du clergé. Il était produit dans des ateliers spécialisés, parfois dans les grandes villes comme Paris, Bruges ou Bologne. On parle ici de luxe spirituel : un objet fait pour durer, pour être beau, mais aussi pour porter une foi sincère.
Enfin, si vous vous demandez pourquoi c’est si bien conservé… c’est grâce aux conditions strictes de préservation. Il faut éviter la lumière directe, l’humidité, et surtout… toujours manipuler avec des gants ! Car même la sueur de nos doigts pourrait altérer les pigments ou ternir l’or.
Ce parchemin, c’est une petite fenêtre ouverte sur le monde médiéval : un monde où prier, écrire et décorer, était tout un art.
12
Remarques sur la langue Françoise de monsieur de Vaugela
Ouvrage de référence sur la codification du français moderne publié par Claude Favre de Vaugelas. Edition originale de 1690
Ecouter l’audio
En savoir
J’ai le plaisir de vous présenter ici une pièce majeure de l’histoire de la langue française.
Ce petit livre que vous voyez là, avec sa belle gravure d’époque et son papier patiné par le temps, c’est bien plus qu’un simple manuel. Il s’agit des Remarques sur la langue françoise de monsieur de Vaugelas. Publié en 1647, cet ouvrage est l’un des fondements de ce qu’on appelle aujourd’hui le “français classique”. Un véritable monument !
Alors qui est ce monsieur Vaugelas ? Claude Favre, seigneur de Vaugelas, fils de Antoine Favre, est un personnage aussi étonnant que discret. Il est né… en Savoie ! Oui, ce grand arbitre du “bon français” était en fait Savoisien !
Et pourtant, c’est lui qui a codifié la langue de la Cour du roi Louis XIII. On le surnommait à l’époque “le greffier de l’usage”, parce qu’il notait avec une extrême rigueur comment les gens bien parlaient à la Cour, dans les salons élégants, chez les grands écrivains.
Ce n’était pas un grammairien enfermé dans ses livres, non, c’était un observateur. Il allait écouter discrètement les conversations dans les salons les plus raffinés de Paris – notamment celui de l’Hôtel de Rambouillet – et il notait : ce mot se dit, celui-là non ; cette tournure est élégante, celle-là à éviter. Il écoutait particulièrement les femmes, parce qu’il estimait qu’elles avaient une langue plus naturelle, moins influencée par les discours juridiques ou religieux.
Dans ses Remarques, Vaugelas ne cherche pas à inventer des règles. Il dit qu’il est seulement le témoin du “bon usage”. Mais attention, le “bon usage”, chez lui, c’est celui de “la plus saine partie de la Cour et des meilleurs auteurs du temps”. Autrement dit, une élite dans l’élite. Il ne s’agit pas du parler du peuple ou des provinces, qu’il jugeait fautif. Non, il voulait fixer une norme, celle d’un français clair, élégant, digne du Roi.
Ce qui est fascinant, c’est l’impact de ce livre. Il a été lu, relu, commenté même par Thomas Corneille, le frère du célèbre dramaturge. Des grands auteurs comme Racine ou Boileau s’en sont inspirés. Corneille, lui, a même modifié ses pièces pour les rendre conformes aux règles de Vaugelas !
L’influence de ce livre ne s’est pas arrêtée là. Il a servi de base à la rédaction du tout premier Dictionnaire de l’Académie française, en 1694. Et devinez quoi ? C’est Vaugelas qui avait commencé à rédiger les premières lettres de ce dictionnaire. C’est un peu le grand-père de tous nos dictionnaires modernes !
Alors, quand vous entendez aujourd’hui quelqu’un dire “ce n’est pas français !” ou “ça ne se dit pas comme ça”, souvenez-vous que, quelque part, c’est encore l’ombre de Vaugelas qui parle. Et tout a commencé ici, en Savoie et à travers ce modeste mais révolutionnaire petit livre.
13
“Mappe Sarde” ou plus précisément Cadastre de Savoie
Carte originale d’une parcelle de La Clusaz issue du cadastre réalisé entre 1728 et 1738.
Ecouter l’audio
En savoir
Approchez vous, observez ce morceau de carte. Je vais vous raconter une histoire fascinante à son sujet. Ce document ancien symbolise à lui seul, la transformation de la société en Savoie comme nul autre. Vous avez devant vous un extrait du cadastre de Savoie, plus précisément celui d’une parcelle de La Clusaz. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, remontons un peu le temps.
Nous sommes au début du XVIIIe siècle, vers 1720. La Savoie, à l’époque, n’est pas française. C’est un pays indépendant flanqué d’une toute nouvelle couronne – c’elle du royaume de Sardaigne. Dirigé par un souverain éclairé : Victor-Amédée II de Savoie. Un roi pas comme les autres. Il veut moderniser son État, mieux maîtriser ses territoires, et surtout… mieux répartir l’impôts. À l’époque, les impôts, n’étaient pas très justes : les nobles et le clergé en payaient très peu, voire pas du tout, pendant que les paysans eux, contribuaient beaucoup.
Victor-Amédée II et son prédécesseur, dans un esprit profondément visionnaire, vont progressivement abolir les privilèges de l’Église, réduire l’autonomie des communes, et même forcer les seigneurs locaux à vendre leurs terres aux paysans. Ce geste fort transforme profondément la société : les paysans, devenus propriétaires, pourront mieux subvenir à leurs besoins, et surtout, ils payeront un impôt plus juste, plus en lien avec leurs ressources réelles.
Pour mener à bien cette entreprise, Victor-Amédée II, a une idée de génie : faire réaliser un cadastre. Un cadastre, c’est une immense opération de mesure et de cartographie du territoire. Il envoi ses géomètres dans chaque ville, chaque village, pour mesurer toutes les terres, noter qui possède quoi, évaluer la qualité de chaque champ, de chaque pâturage. Résultat : une carte hyper précise, qu’on appelle une “mappe”, et des registres détaillés, un peu comme une fiche d’identité pour chaque parcelle. L’élaboration du cadastre de la Savoie prendra 10 ans.
Pourquoi c’est révolutionnaire ? D’abord, parce que c’est une première. Aucun autre État en Europe à l’époque n’avait abolie les privilèges féodaux et encore moins cartographié son territoire avec une telle précision. Ensuite, parce que ça change la donne : désormais, chacun doit contribuer à l’impôt en fonction de ce qu’il possède réellement. Fini les déclarations à la louche, les estimations injustes… On passe à une fiscalité beaucoup plus équitable.
Alors en observant cet extrait de La mappe d’une partie de la Clusaz, vous ne regardez pas juste une vieille carte. Vous contemplez un morceau d’histoire, une révolution qui a transformé durablement le lien entre l’État et ses habitants, permettant au petit peuple de devenir propriétaire. Voilà toute la magie du cadastre de la Savoie !
14
Tabula Generalis Sabaudiae Ducatus
Carte originale des états de Savoie réalisée par Giovanni Tomaso Borgonio et gravé à Amsterdam dans l’atelier de Johannes Blaeu en 1690.
Ecouter l’audio
En savoir
Ici, je vous propose un petit voyage dans le temps, à la découverte d’une œuvre aussi belle qu’ambitieuse : le Theatrum Sabaudiae. Et juste devant vous, voici la toute première image qu’on y découvre : le Tabula Generalis Sabaudiae Ducatus.
Mais avant de plonger dans les détails de cette carte, il faut qu’on comprenne ce qu’est ce fameux Theatrum.
Alors, imaginez un grand livre, très grand, qu’on n’ouvre pas sur ses genoux mais sur une table. Un ouvrage luxueux, imprimé à la fin du XVIIe siècle, qui rassemble plus de 140 grandes planches gravées, chacune illustrant une ville, un château, un palais ou un paysage des États de Savoie.
On y voit Turin, Chambéry, Thonon, les fortifications de Pignerol… Tout est présenté de manière très soignée, parfois même embellie, presque comme des tableaux.
Ce n’est pas un livre pour apprendre à se repérer comme un GPS : c’est une mise en scène, un théâtre – Theatrum, en latin – du pouvoir. Un livre conçu pour impressionner. Car à cette époque, les cartes ne servent pas seulement à se repérer. Elles montrent aussi la puissance d’un État, elles racontent une histoire politique.
Et justement, cette œuvre a été commandée par le Duc Charles-Emmanuel II de Savoie pour montrer au reste de l’Europe que la Savoie n’est pas un petit État montagnard, mais un territoire organisé, ambitieux, digne des grandes puissances. le Theatrum Sabaudiae servait de cadeaux diplomatique.
Et c’est là qu’intervient notre carte, le Tabula Generalis qui est l’œuvre de Giovanni Tomaso Borgonio, cartographe de la cour de Savoie, et Joannes de Broen, graveur à Amsterdam. Ce Tabula se trouve tout au début du Theatrum, comme un prologue visuel. Elle résume l’ensemble du territoire : le duché de Savoie, le Piémont, le comté de Nice… Regardez comme les montagnes, les rivières, les villes y sont soigneusement dessinées.
À droite et à gauche, des petits anges, qu’on appelle « putti », tiennent les blasons des différentes provinces. Ce n’est pas juste décoratif : c’est une façon de dire que tous ces territoires sont unis sous la même autorité, celle du duc de Savoie.
Cette carte, c’est donc à la fois une œuvre d’art, un outil de communication politique, et un vrai bijou technique.
Elle a été réalisée à Amsterdam, dans l’atelier de Johannes Blaeu, un des plus grands cartographes de l’époque.
Blaeu, c’est un peu l’éditeur de luxe de l’époque. Son atelier, financé notamment par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, est connu pour produire les plus beaux atlas du monde. L’ouvrage Atlas Maior, un monument en douze volumes, avec près de 600 cartes. Autant dire que Blaeu est la référence absolue !
Et pour vous donner une idée de son prestige : les exemplaires du Theatrum Sabaudiae étaient si précieux qu’on les transportait depuis les Pays-Bas jusqu’en Savoie via la méditerranée, sur des bateaux spécialement construits pour eux !
Alors, quand vous regardez cette carte, ne la voyez pas seulement comme un vieux document : voyez là comme une scène d’ouverture. Le rideau se lève, le décor est en place. Et derrière chaque ligne, chaque symbole, il y a une intention : montrer la grandeur, l’unité et l’identité d’un État prêt à se faire une place sur la scène européenne.
15
Nicaea civitas sacris monumentis illustrata
Livre sur l’histoire de Nice illustrée par ses monuments sacrés. Edition originale de 1658 imprimée à Turin.
Ecouter l’audio
En savoir
Avec cet ouvrage, nous allons revenir au XVIIe siècle, et partir à la découverte de l’histoire ancienne de la ville de Nice : Nicaea civitas sacris monumentis illustrata, ou « Nice, cité illustrée par ses monuments sacrés », rédigé en 1658 par un érudit local, l’abbé Pierre Gioffredo.
Alors… qui était ce monsieur ? Né à Nice en 1629, il était à la fois prêtre, enseignant et passionné d’histoire. Avant de devenir historien officiel à la cour du duc de Savoie, il dirigeait les écoles primaires de la ville. Mais c’est son amour pour Nice qui l’a poussé à écrire ce grand livre, tout en latin – la langue des savants à l’époque – pour raconter notre histoire, depuis l’Antiquité jusqu’à son époque.
L’un des faits clés qu’il souligne, c’est l’importance de la Dédition de Nice à la Savoie, en 1388. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est un moment crucial : cette année-là, Nice décide de se placer volontairement sous la protection du comte de Savoie, rompant avec les Anjou proches du royaume de France. Ce choix politique change durablement l’histoire de la ville, qui devient un port stratégique pour les États de Savoie, ouvrant sur la Méditerranée.
Et ce lien avec les États de Savoie, Gioffredo le connaît bien. Son livre s’inscrit pleinement dans cette histoire. Il ne se contente pas de raconter les origines grecques ou romaines de Nice – comme la fondation par les Grecs de Marseille ou l’importance de Cimiez, l’ancienne Cemenelum romaine. Non. Il consacre aussi beaucoup de place à ce qui fait la singularité de Nice selon lui : sa foi chrétienne.
L’ouvrage met en avant les monuments sacrés, les saints locaux comme saint Pons ou sainte Dévote, les évêques successifs, les couvents, les confréries religieuses… Pour Gioffredo, Nice est une cité sacrée, protégée et honorée par son passé religieux.
Le livre n’a pas été imprimé ici, mais à Turin, la capitale de la Savoie. Et ce n’est pas un hasard. En racontant l’histoire pieuse et prestigieuse de Nice, Gioffredo servait aussi un objectif politique : mettre en valeur l’importance de la ville dans les États de Savoie, dont elle faisait partie depuis la fameuse Dédition.
Ce livre a eu un énorme retentissement. Il a permis à Gioffredo de devenir historien officiel, puis précepteur du futur roi de Sardaigne. Et encore aujourd’hui, les historiens y reviennent : il ne faut pas tout y prendre pour argent comptant – c’est aussi un mélange de faits, de légendes et de foi – mais c’est une source précieuse pour comprendre comment Nice voyait son propre passé.
Avec Gioffredo, on découvre une autre facette de Nice : non pas une ville uniquement provençale ou méditerranéenne, mais niçoise et savoisienne, fière de ses racines religieuses et historiques.
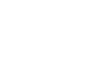
Savoie.live est une association, loi 1901, dont l’objet est la sauvegarde, la promotion et la valorisation de l’histoire, du patrimoine et de la culture de la Savoie historique.
Pour en savoir plus :